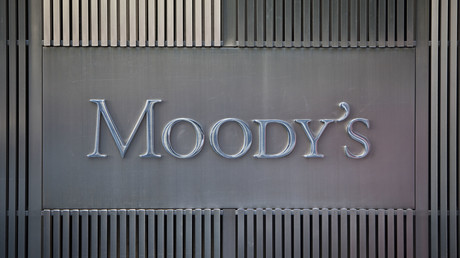Entre Alger et Paris, la guerre des mémoires n’est pas finie. Pour l’analyste et universitaire libyen Mustafa Fetouri, la France reste prisonnière de son passé colonial : ni excuses, ni réparations, et une diplomatie qui ravive les blessures. L’Algérie, elle, exige qu’on nomme le crime et que la mémoire devienne justice.
Chaque année, l’Algérie commémore plusieurs dates historiques liées à l’époque de l’« Algérie française », département officiel d’outre-mer français. Deux parmi elles occupent une place particulière : le 5 juillet 1962, Fête de l’Indépendance marquant la proclamation de la souveraineté, et le 1er novembre 1954, Fête de la Révolution commémorant le soulèvement qui a déclenché la guerre de libération.
Il ne s’agit pas de célébrations ordinaires − elles rappellent que les plaies de la colonisation sont toujours saignantes. En ce mois de novembre, le 71e anniversaire survient dans un contexte de crise diplomatique sans précédent depuis des décennies : expulsion de diplomates, suspension de la coopération et soutien de Paris à la revendication marocaine du Sahara occidental, perçu à Alger comme une provocation.
Vestiges du colonialisme français
Aucune des commémorations nationales en Algérie n’est associée à la tranquillité ou à la joie, car chacune est imprégnée de la commémoration des victimes. Elles rappellent le sang versé et la résilience qui ont transformé le pays, d’un département français d’outre-mer en un État souverain. Le 1er novembre 1954 demeure la date la plus marquante : le jour où le Front de libération nationale (FLN) lança son soulèvement entraînant les citoyens ordinaires dans une lutte collective, non seulement pour reconquérir leur terre, mais aussi pour forger un modèle africain de libération. L’expérience algérienne inspirera plus tard les mouvements d’indépendance à travers l’Afrique, dont beaucoup adopteront ses stratégies et sa méthode organisationnelle dans leurs combats contre le pouvoir colonial, y compris français.
Sept décennies après le début de la révolution, les vestiges du colonialisme français planent encore sur l’Algérie et la France, bien que pour des raisons différentes. L’Algérie exige de reconnaître, de répondre pour ces actes et de payer des compensations, tandis que la France préfère oublier son passé ou du moins le ranger aux oubliettes.
C’est la première fois où ces commémorations ont lieu à un moment aussi délicat pour les relations entre Alger et Paris. Pour compliquer encore plus les choses, la France a ouvertement choisi de soutenir la revendication marocaine sur le Sahara occidental − une prise de position qu’Alger perçoit comme une provocation et un mépris de son influence dans la région. Dans ce contexte, cela ajoute aux commémorations une signification particulière. La même lutte pour l’indépendance, qui exigea jadis des sacrifices, influence aujourd’hui la position de l’Algérie vis-à-vis de la France, rappelant à Paris que les questions irrésolues de responsabilité restent d’actualité, tant dans la diplomatie officielle que dans la mémoire collective.
Lutte autour de la mémoire
Les revendications de l’Algérie en matière de reconnaissance sont précises et anciennes. L’un des sujets les plus poignants est la restitution des crânes de soldats algériens que la France prit comme trophée durant la conquête française. Ces restes humains furent gardés dans des musées français pendant plus d’un siècle et, de temps en temps, exposés publiquement d’une manière que plusieurs considèrent comme une glorification de la conquête coloniale plutôt qu’une reconnaissance des atrocités commises. En juillet 2020, la France a restitué 24 de ces crânes à l’Algérie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a alors déclaré que ces soldats « avaient été privés de leur droit inhérent et humain à être enterrés pendant plus de 170 ans », soulignant ainsi la portée morale et historique de la restitution.
Un autre grief concerne l’accès aux archives coloniales, notamment aux dossiers détaillant les massacres, les tortures et les essais nucléaires que la France mena dans le désert algérien en 1960. Même si la France ouvrit partiellement certaines archives, plusieurs documents essentiels restent classifiés, ce qui frustre tant les historiens que les fonctionnaires algériens. Outre la restitution matérielle, l’Algérie espère toujours une reconnaissance officielle des atrocités commises par la France, comme les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en mai 1945, ainsi que du recours systématique aux tortures pendant la guerre.
Macron en quête d’un équilibre
La lutte autour des narratifs et de la mémoire s’est ainsi transformée en un champ de mines diplomatique qui continue à façonner les relations franco-algériennes actuelles, des questions migratoires et des restrictions de visas jusqu’au déclin de l’influence française au Maghreb. Chaque tentative de réconciliation, y compris les visites officielles, est empreinte d’une méfiance née d’un siècle et demi de domination et de décennies de rhétorique française ambiguë depuis l’indépendance de l’Algérie.
Le président Macron oscille entre une reconnaissance prudente et un déni défensif. En 2017, alors candidat à la présidence, il avait qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité ». Une fois à l’Élysée, cependant, il s’est replié sur le terrain plus sûr du « je n’ai pas à demander pardon », tout en offrant ce qu’il a appelé des actes de reconnaissance. Cette approche nuancée révèle le profond malaise de la France : alors qu’elle semble confronter son terrible passé, elle souhaite éviter toute conséquence légale.
La question de l’existence de la nation algérienne avant la colonisation française, posée par Macron en 2021, a provoqué une indignation à Alger et entraîné le rappel de l’ambassadeur d’Algérie ainsi que la fermeture temporaire de l’espace aérien français pour les vols militaires à destination du Sahel. Ces erreurs montrent à quel point les relations entre les deux pays sont fragiles et facilement perturbées par des paroles ravivant les traumatismes de la colonisation.
Même si Macron a essayé par la suite de réparer les dommages, appelant à la « vérité » et à la « réconciliation » et visitant Alger en 2022, ces gestes ont été considérés de manière sceptique. Pour de nombreux Algériens, la non-volonté de la France de s’excuser officiellement, d’ouvrir toutes les archives ou de reconnaître pleinement ses crimes rend ces gestes vains. Alger considère souvent le changement de ton de Paris comme le reflet de la politique intérieure française, où l’histoire coloniale reste un sujet controversé, exploité par l’extrême droite et abordé avec prudence par les dirigeants centristes.
Nouveau levier de l’Algérie
Cependant, la dynamique entre les deux pays n’est plus fondée sur la dépendance. Aujourd’hui, l’Algérie interagit avec la France en position de force relative. En s’appuyant sur ses revenus énergétiques, son influence régionale et une confiance renouvelée dans son identité postcoloniale, l’Algérie a appris à utiliser l’histoire comme un levier. Dans les moments de tensions, elle rappelle à Paris son passé colonial, laissant entendre que la réconciliation ne peut se produire aux conditions de la France. L’ancienne colonie fixe désormais de nombreux paramètres moraux et diplomatiques de la coopération, obligeant la France à accepter une inversion inconfortable des forces historiques.
L’Algérie, forte de son assurance, cherche également de nouveaux alliés. En 2024, les échanges commerciaux entre la Russie et l’Algérie ont doublé et atteint environ 2 milliards de dollars américains. Les deux parties voient un potentiel d’augmentation jusqu’à 10 milliards de dollars américains d’ici 2030. Le commerce avec la Chine a atteint environ 12,48 milliards de dollars en 2024, ce qui souligne l’élan stratégique de l’Algérie vers la diversification de ses partenariats.
Malgré les échecs régionaux, les perspectives de l’Algérie restent stables et la France ne gagnera guère à affaiblir l’Algérie dans la région. Le conflit continu au sujet du Sahara occidental reste controversé, car l’Algérie soutient les revendications d’indépendance du Front Polisario. La reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental est largement considérée comme une manœuvre visant à faire pression sur l’Algérie sur d’autres questions bilatérales, y compris le passé colonial. Dans le même temps, la France cherche à compenser son influence déclinante au Sahel, en particulier dans les pays voisins au sud de l’Algérie, tels que le Niger, où l’influence française est aussi en déclin.
Il semble que la détérioration des relations franco-algériennes soit cette fois plus grave que jamais. Les canaux diplomatiques fonctionnent mal, et les dirigeants algériens se sentent trahis par la position oscillante de Macron, qui avait autrefois qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité ». Aujourd’hui, avec une posture politique différente, les Algériens sont pleinement conscients de la reconnaissance et des rhétoriques sélectives, ainsi que des actions minimalistes de la France. La présence continue de Macron à l’Élysée limite les espoirs d’un véritable changement de la politique française en matière de responsabilité coloniale.
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.